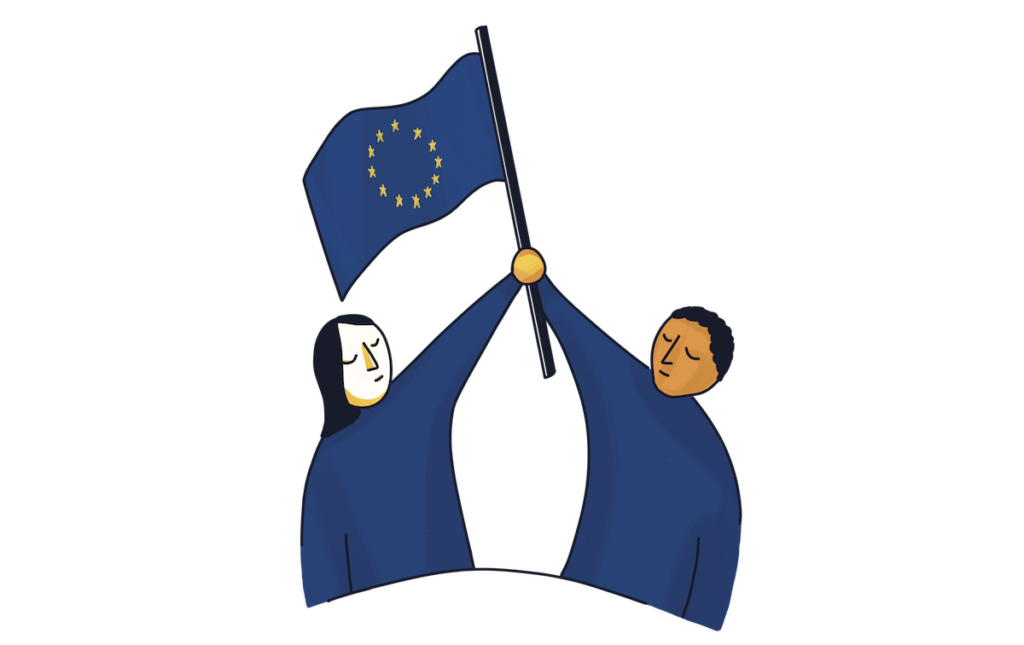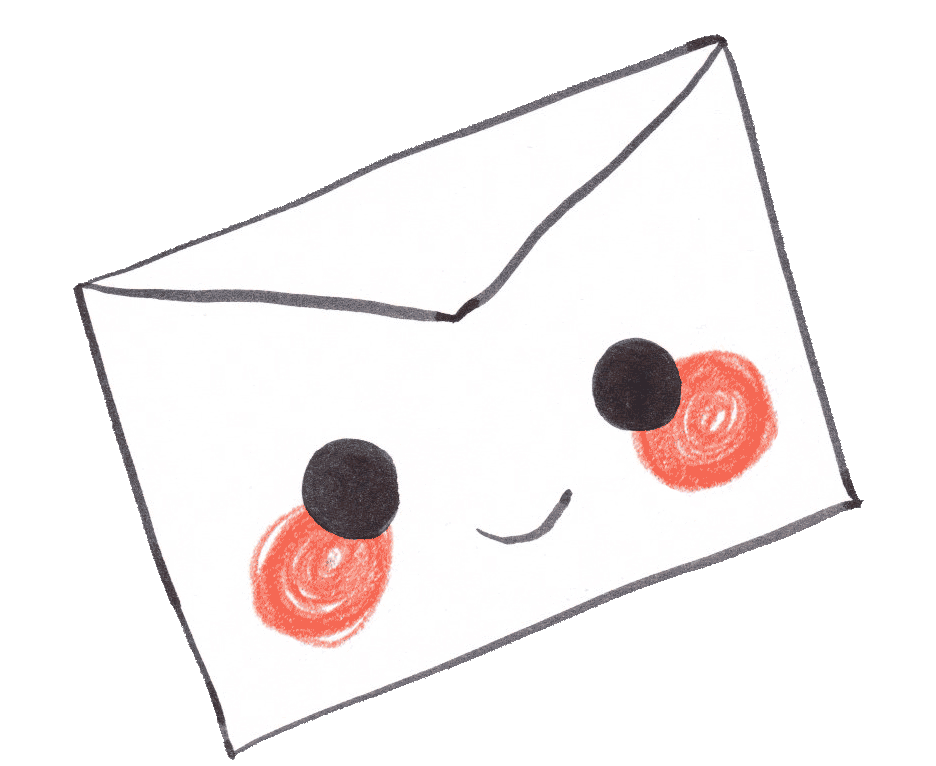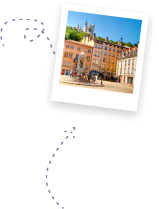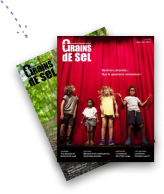Avec le réchauffement climatique, les stations de ski font face à un enneigement de plus en plus aléatoire qui questionne la durabilité d’un modèle économique fondé sur le ski alpin. D’où la nécessité pour les collectivités de développer un tourisme écoresponsable moins dépendant de la neige. Autour de Lyon, certaines stations entament leur transition vers un modèle quatre saisons, voire anticipent la fin du ski. Ce qui n’empêche pas d’y trouver de chouettes activités pour profiter de la montagne… même sans neige !
Lire la suite du dossier sur Grains de Sel : Réchauffement climatique: le défi des stations de ski
À Chamrousse (Isère), on diversifie les activités pour moins dépendre du ski
Plébiscitée des Lyonnais, Chamrousse, station de moyenne montagne en Isère, est le territoire où fut testé Climsnow. Développé par Météo-France et l’INRAE*, cet outil permet d’estimer à moyen et long terme la variabilité de l’enneigement et donc aux stations d’adapter leur stratégie touristique. Et d’après les estimations, « Chamrousse est plutôt bien situé pour avoir un recul de neige moins rapide, rapporte Sophie Delastre, chargée de mission Environnement à Chamrousse.
Pour autant, il ne faut pas se dire qu’on a le temps de voir venir. On se rend compte que l’évolution de l’enneigement n’est pas linéaire mais qu’il devient chaotique : il est possible qu’on ait des années sans neige dans les 30 ans à venir. Sans compter que l’outil doit être actualisé selon les dernières études du GIEC qui montrent que le réchauffement climatique est plus rapide que prévu. »
D’une station de ski à une station de montagne
Alors Chamrousse entame sa « transformation en station de montagne quatre saisons » et diversifie ses activités pour proposer des loisirs pouvant se faire aussi bien sur neige que sans. Parmi elles, un projet de luge sur rail et une tyrolienne géante mise en service cet été. La station, qui bénéficie d’un point culminant à 2 250 mètres, mise aussi sur son patrimoine géologique et a installé une passerelle himalayenne au-dessus du couloir de Casserousse.
Les accompagnateurs de montagne proposent, eux, des sorties à thème – à pied ou en raquettes – sur le chant des oiseaux ou encore sur le retour du loup dans les montagnes (dès 6 ans). Des jeux de piste sont aussi pensés pour tous les âges : le parcours du Petit Montagnard (dès 3 ans) mènera les familles d’énigme en énigme à la découverte des animaux. L’Explor Games, lui, plongera les ados dès 12 ans dans le Chamrousse de différentes époques grâce à une tablette numérique.
« Flocon Vert est le référentiel le plus exigeant qui existe pour amener stations et élus à se poser les bonnes questions«
Camille Rey-Gorrez
Une station labellisée Flocon Vert
« Chamrousse a tout pour réussir sa transition. Mais elle vient d’investir dans une retenue collinaire, regrette Valérie Paumier. À ces altitudes-là, on ne devrait plus investir dans le produit neige. » Ce qui n’empêche pas la station d’être labellisée Flocon Vert. Créé par l’association Mountain Riders, le label accompagne les stations dans leur transition d’après un cahier des charges actualisé en 2022. « À Chamrousse, le poids du ski dans le modèle global est encore trop fort, mais ils sont déterminés à avancer, indique Camille Rey-Gorrez, directrice de l’association. Flocon Vert est le référentiel le plus exigeant qui existe pour amener stations et élus à se poser les bonnes questions. Mais on ne transforme pas une collectivité du jour au lendemain. »
Référente Flocon Vert à Chamrousse, Sophie Delastre explique la démarche de labellisation, semée d’audits réguliers pour attester une démarche de progression de la part des stations. « Le label peut être accordé à des stations qui sont à des stades différents, mais qui s’engagent à s’améliorer, précise-t-elle. Pour les domaines skiables, c’est un outil de suivi très utile qui oblige la Mairie et les remontées mécaniques à travailler ensemble. » À Chamrousse, le label a permis cette année de faire le bilan carbone de la collectivité. Il permet aussi la mise en réseau des stations pour partager les bonnes pratiques.
Que faire à Chamrousse ?
• Balade « Le retour du loup dans nos montagnes », dès 6 ans, jusqu’au 16 avril, tous les jours de 8h à 19h. Tarif : 15 à 25 €. Sur réservation. Plus de balades auprès du Bureau des guides et accompagnateurs de Chamrousse : guides-chamrousse.fr – 04 76 59 04 96.
• Jeux de piste, parcours du Petit Montagnard : dès 3 ans, durée 45 min, 2 km. Au départ de Chamrousse 1650 – Recoin. Livret à récupérer à l’Office du tourisme.
• Explor Games : dès 12 ans, durée 1h30. Départ : Maison de l’Environnement de Chamrousse. Arrivée : Croix de Chamrousse. Télécharger l’application « Chamrousse Explor Games® ». Gratuit mais nécessite un forfait pour accéder à la télécabine. Jusqu’au 18 avril, aux dates et horaires d’ouverture de la télécabine de la Croix de Chamrousse. Plus de jeux de piste sur chamrousse.com/jeux-piste-escape-game – 04 76 89 92 65.

À Métabief (Doubs), on anticipe la fin du ski en 2035
Dans les montagnes du Jura, la station de ski Métabief est engagée depuis 2015 dans sa reconversion en station de montagne. Elle y a consacré un site, o-doubs.com, qui partage des ressources pour « construire de nouveaux modèles touristiques résilients ». « L’impact du réchauffement climatique est très fort sur notre territoire et risque de rendre l’activité de ski alpin économiquement non viable à une échéance proche », peut-on y lire. En 20 ans, le domaine skiable a en effet vu sa limite pluie/neige monter de 200 mètres. Or, la station dépend à 90 % du ski alpin. Et contribue à 50 % de l’économie touristique du territoire.
Faire le deuil du ski
Alors, pour ne plus investir à perte dans un modèle tout ski condamné, la station anticipe sa reconversion.
« On imagine la fin du ski alpin à horizon 2035, ce qui est fort probable, témoigne Olivier Érard. On le maintient tant qu’on peut, mais on ne fait plus d’expansion de neige de culture. En dessous de 1800 mètres, c’est de plus en plus compliqué d’en faire et nos collectivités ne peuvent pas nous mettre sous perfusion. » La station a aussi cessé d’investir dans de lourds équipements de ski : elle s’en tient à la maintenance et transforme certains équipements en modèles toutes saisons. Ainsi la luge sur rail est-elle sortie de terre.
« La fin de ce modèle est difficile à accepter…«
Olivier Érard
« La fin de ce modèle est difficile à accepter, confie Olivier Érard. La neige, le ski, ça connote l’enfance… C’est des deuils qu’il faut faire. Ce n’est pas un choix politique, mais un fait avec lequel on est obligé de composer. Il faut tout de suite dire aux territoires qui dépendent de stations comme la nôtre: “attention, dans 10–15 ans, le gâteau va disparaître.” La transition demande beaucoup de psychologie et de souplesse pour embarquer les gens. »
Un modèle de transition pour les stations de ski
Aujourd’hui, Métabief est un vrai laboratoire d’expérience d’une transition des stations de ski. Elle est la seule station à recourir au plan Avenir Montagne, qui donne des moyens pour « se mettre au service des porteurs de projets hors neige, explique Olivier Erard. L’objectif est que des communautés d’acteurs autonomes réinventent l’économie touristique en montagne. Les solutions émergeront si on sait accompagner, créer les conditions de coopération et si on est inventifs. »
À titre d’exemple, un magasin de sport très axé ski se diversifie en VTT en travaillant avec le parc du Haut Jura. Pour sa démarche visionnaire, en 2021 la station a été choisie par l’État pour le lancement des États généraux de la transition du tourisme en montagne. « La façon dont on anticipe la fin du ski fait figure de modèle, avoue humblement Olivier Érard. Notre retour d’expérience intéresse car on est les seuls à mettre la théorie en application. »
Que faire à Métabief ?
• Métabief Aventures. Parc de jeux avec parcours dans les arbres, tyrolienne, passerelle en bois, trampoline, toboggan, jeux gonflables, tir à l’arc… Dès 3 ans. Ouvert tous les jours de 11h à 18h en février. Tarif : 9€. Les enfants de –12 ans doivent être avec un adulte. 2 chemin du Centre équestre, Métabief – 03 81 49 20 14.
• Luge des cimes. Accessible toute l’année, cette luge sur rails propose un parcours de 710 m de long pour des tours à 40 km/h en vitesse de pointe. La nuit tombée, les lumières et la musique lui donnent des airs de
fête foraine. Dès 3 ans. Tous les jours de 13h à 18h, jusqu’à 20h les mardi et samedi. De 5 à 7 €. Place Xavier-Authier, Métabief. station-metabief.com – 03 81 49 20 00.
Où dormir à Métabief ?
• Chalet en bois des Equipages Adam’s. Tenu par une équipe de mushers, ce chalet en bois pouvant accueillir 4 personnes est situé en lisière de forêt et à proximité de la meute de chiens nordiques. Attention, il faut apporter son linge de lit et de toilette. Enfants dès 6 ans. À 20 minutes de Métabief. Tarifs : 50€ pour deux personnes, 5€ supplémentaires par enfant. Combe des Cives, Chaux-Neuve. lesequipagesadams.com – 09 75 58 40 83.

Dans la Drôme, on plante des forêts pour retenir la neige
« D’après Climsnow, en 2050, on aura au mieux un mois et demi d’enneigement en dessous de 1300 mètres, avertit le directeur des stations de la Drôme Cédric Fermond. On s’est fixé un seuil d’un mois d’ouverture pour maintenir le ski sur une station. D’ici 2030, trois vont certainement devoir y renoncer. » Alors pour emmener ses sept stations de moyenne altitude dans la transition, la Drôme se montre audacieuse. Dans son Plan stratégique des stations 2022–2026, le Département table sur quatre axes, parmi lesquels tourner définitivement le dos à la neige de culture.
Des forêts au lieu des canons à neige
Une décision basée sur de multiples études pour évaluer l’impact de réseaux de neige de culture sur le territoire. « Le Vercors est un secteur à enjeu environnemental fort, classé zone Natura 2000, avec des sources et une configuration de station atypique », expose Cédric Fermond. Verdict : un coût financier et environnemental trop élevé. « Ce n’est pas tant le critère économique qui nous a décidés, mais l’impact sur la biodiversité, précise Christian Morin, président des stations et conseiller départemental. Or le Département met en avant ses espaces naturels. Il était plus logique d’enclencher la transition. »
Pour fonctionner sans canons à neige, le Département mise alors sur les arbres. « On se rend compte que notre premier ennemi, c’est le vent qui chasse la neige, explique Cédric Fermond. Par ailleurs, celle-ci tient mieux dans les zones ombragées. » Les stations installent donc des barrières à neige et reboisent les domaines pour que la forêt prenne progressivement le relais. Un projet pionnier qui débute tout juste. Mais qui sert surtout à alimenter les pistes de ski de fond. Pour les pistes alpines, il s’agira d’accepter les aléas climatiques : « Quand il y aura de la neige, on fera du ski ; quand il n’y en aura pas, on fera autre chose ! », résume le directeur des stations.
« Quand il y aura de la neige, on fera du ski ; quand il n’y en aura pas, on fera autre chose !«
Cérdic Fermond
Des activités modulables avec ou sans neige
S’il continue d’investir dans le ski alpin au-dessus de 1 300 mètres, le territoire drômois entend aussi réduire sa dépendance à la neige grâce à des activités plus diversifiées. « On dépend des activités neige à 73 %. On se donne 10 à 30 ans pour l’abaisser à 58 % », expose le conseiller départemental. Sous les 1300 mètres, les stations misent donc sur le ski de fond ou le ski nordique, « modulables avec ou sans neige et qui se prêtent bien aux espaces sauvages du Vercors », explique Cédric Fermond. De nouveaux itinéraires raquettes sont ainsi en cours de balisage.
Les stations développent aussi d’autres activités comme le tir à l’arc. Dès 8 ans, les enfants pourront s’initier au stade Raphaël-Poirée de la station du Col de Rousset ou à travers deux parcours aux stations Font d’Urle et Lus La Jarjatte, en raquettes ou à pied selon les conditions d’enneigement. Et, plus insolite encore, apprendre le ski… mais à roulettes !
Que faire dans les stations de la Drôme ?
• Balades (en ski nordique ou à pied). Parcours familial « Le sentier du bois du loup » (2,5 km) dès 5 ans. Explor Games « Les fabuleux mystères du Vercors », une quête pour découvrir pourquoi l’eau a disparu sur le Vercors, sur le sentier du Bois du Loup. Dès 8 ans. Tablettes en location à la station Col de Rousset. Départ de la station. 18 €/personne. 04 75 48 24 64. « Sentier de l’ours du Vercors » (10,7 km), dès 10 ans.
Plan à récupérer à la station du Col de Rousset. Départ de la station. Vue sur les hauts plateaux à la clé.
• Luge sur rail. Dès 8 ans ou en duo parent-enfant dès 4 ans. Station Col de Rousset. Ouvert selon l’enneigement.
• Tir à l’arc. Dès 8 ans. Stade Raphaël-Poirée de la station Col du Rousset, ou dans les stations Font d’Urle et Lus La Jarjatte. Durée 45 min/1h.
• Initiation au ski à roulettes. Dès 8 ans. Piste de 2 km, stade Raphaël-Poirée, station du Col du Rousset. Ouvert en février si mauvaise condition d’enneigement, de 13h30 à 17h. Sans réservation. Matériel fourni. Plus d’info sur lesstationsdeladrome.fr ou auprès de l’Office de tourisme du Vercors-Drôme : vercors-drome.com – 04 75 48 22 54.

Rédigé par Louise Reymond • Photo d’ouverture © Millo Moravski